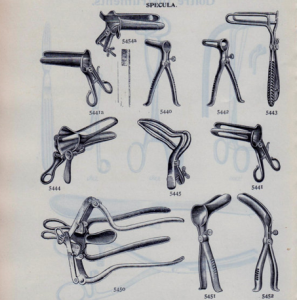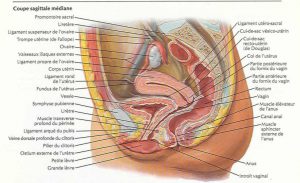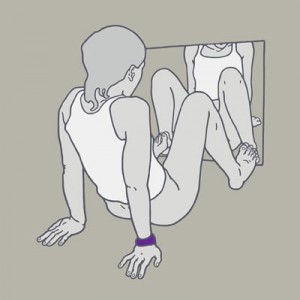definition wikipedia:
Les termes de troisième sexe ou de troisième genre désignent soit des individus qui sont considérés comme n’étant ni homme ni femme, soit des individus appartenant à une catégorie sociale dans des sociétés qui reconnaissent trois genres ou plus.
L’état de n’être ni homme ni femme peut faire référence au sexe biologique, au rôle traditionnel des sexes, à l’identité sexuelle ou à l’orientation sexuelle. Selon différentes cultures, le troisième sexe peut désigner un état intermédiaire entre l’homme et la femme ou une appartenance simultanée aux deux sexes (dans des expressions comme « l’esprit d’un homme dans le corps d’une femme »), l’état de neutralité, la capacité à changer de sexe, ou encore une catégorie complètement séparée d’homme et de femme. Cette dernière interprétation est considérée comme la plus stricte. Selon les époques ou les contextes, le terme « troisième sexe » peut être utilisé pour désigner les travestis, les transsexuels1, voire (parfois sous forme d’euphémisme) les homosexuels dans leur ensemble2.
Ce terme a été utilisé pour décrire les chamanes, sipiniit et enfants inversement socialisés dans la culture inuit3, les Hijra d’Inde et du Pakistan4, les Raerae de Polynésie, les Sworn virgin des Balkans5, entre autres, et il est utilisé par certains de ces groupes pour se décrire eux-mêmes. Dans le monde occidental, les homosexuels, transgenres et intersexes ont été décrits comme faisant partie d’un troisième sexe, bien que certains contestent cette qualification.
Le terme « troisième » est habituellement compris comme « autre ».
Cibles de violences, les 500 000 travestis, castrats et transsexuels pakistanais sortent, lentement, de leur état de parias avec la reconnaissance récente de leur identité. Une révolution en pays islamique.
Dès leur entrée, elles ont senti le mépris s’abattre sur leurs silhouettes abîmées par la vie. Drapées dans des tuniques féminines bariolées, Sahrish et Annie encaissent en tremblant et baissent les yeux. Leur cœur se serre, une fois de plus. Silence et réprobation parcourent la foule de centaines d’hommes qui attendent leur tour dans ce centre administratif de Karachi. «Tous ces gens qui nous fixent…» souffle la voix androgyne de Sahrish, beauté troublante dont les bijoux camouflent presque parfaitement une barbe naissante. Sahrish et Annie sont issues de la communauté la plus discriminée du pays : les hijras. Ce mot ourdou, traditionnellement traduit par «eunuque» en référence à la tradition moghole des castrats, regroupe les travestis, les transgenres, les hommes castrés par choix personnel et les hermaphrodites. Au nombre de plus d’un demi-million au Pakistan, les hijras connaissent une vie de parias, humiliées, violentées, à des années lumières du temps où les empereurs de la dynastie moghol avaient fait des eunuques leurs danseurs favoris à la cour, les gardiens de leur harem, voire leurs généraux et magistrats.
Pourtant, en ce jour de janvier, Sahrish et Annie ont décidé d’affronter l’opprobe. Elles sont venues réclamer leur carte d’identité du «troisième genre», en application du droit qui leur a été attribué en 2011 par l’austère République islamique du Pakistan . Cette carte leur permettra, notamment, de voter lors des prochaines élections, comme membre de leur communauté hijra, et non plus en tant qu’homme. Elle leur garantira aussi, peut-être, un peu de sécurité. «Plusieurs fois, j’ai été arrêtée par des policiers saouls ou d’autres individus qui m’ont dépouillée, violée et abandonnée à l’autre bout de Karachi,mégalopole de 18 millions d’habitants, confie la fragile Sahrish, 20 ans. Je me sens femme depuis que je suis enfant. J’espère que je serai plus respectée en obtenant cette carte et ces nouveaux droits.»
La bienveillance d’Allah
Dans un Pakistan de plus en plus intolérant et violent envers ses minorités, où l’homosexualité est illégale et le sexe hors mariage un tabou, être hijra est une malédiction. Pour fuir la honte qu’elles attirent sur leur famille et la discrimination à l’école, la plupart rejoignent les villes à l’adolescence et sont contraintes de se prostituer ou de mendier pour survivre. Recueillies par un gourou, parfois proxénète, elles gagnent parfois un peu d’argent – ainsi Sharish et Annie – en dansant dans les mariages et lors des fêtes données pour la naissance d’un garçon : les prières de ces êtres considérés comme des «misérables» sont en effet censées attirer l’attention bienveillante d’Allah et porter bonheur.
Les hijras ne sont pas pour autant protégées du racket, du harcèlement et des viols qui font leur quotidien : on inflige à une hijra ce que l’on n’oserait faire à personne. Surtout quand celle-ci est vulnérable comme Asma (prénom modifié), stupéfiante femme de 26 ans, longue silhouette recroquevillée dans une pièce du modeste siège d’une association de défense des droits des hijras de Karachi. Corps moulé dans une robe de dentelle rouge au décolleté sexy obtenu en abusant de «lotions très efficaces» et de coussinets, sourcils impeccablement dessinés et lunettes fumées achèvent de créer l’illusion, n’était un duvet de moustache et une voix masculine.
Asma rend visite à la présidente de l’association, Bindya Rana, activiste le jour et actrice de série télé la nuit, que tout le monde ici appelle «Mama». Guirlandes en plastique et perroquets multicolores peints sur les murs donnent une touche accueillante à la pièce, baignée dans une entêtante odeur de haschisch. Asma se prostitue à Karachi depuis l’âge de 19 ans. Elle aussi a vécu l’enfer. Soulevant sa robe, elle dévoile un dos balafré d’une plaie impressionnante. Il y a cinq ans, un homme l’a entraînée avec cinq de ses amis passablement éméchés. L’ambiance a dégénéré, le type l’a blessée avec une bouteille de verre. Un an auparavant déjà, un homme «qui paraissait gentil» l’avait ramenée chez lui avec trois autres amis. Elle y fut droguée et violée en réunion, avant d’être abandonnée à une station de bus, en pleine nuit. «Ils ont aussi utilisé des objets, je saignais tellement, j’ai souffert pendant deux mois», raconte-t-elle, le visage blême.
Ces récits des violences masculines sont légion. Un homme, cependant, a mené la bataille judiciaire pour que les castrats, travestis et transsexuels pakistanais «soient enfin traités comme des êtres humains et protégés» : l’avocat Aslam Khaki. Fin 2009, il a trouvé un allié de poids dans la personne du puissant chef de la Cour suprême Iftikhar Mohammad Chaudhry, qui a ordonné au gouvernement de considérer les hijras comme un genre à part entière. En 2011, leurs droits, notamment en matière d’héritage, étaient reconnus, tandis que des mesures étaient prises pour les protéger du harcèlement policier et leur attribuer des emplois décents – notamment dans la fonction publique -, alternative à la prostitution et la mendicité. Enfin, en novembre 2011, la Cour suprême exigeait qu’elles soient inscrites comme électrices en tant que hijras. La procédure d’enregistrement vient d’être ouverte. Ainsi le Pakistan, l’un des seuls pays au monde qui les reconnaît comme un «troisième genre», a même pris une longueur d’avance sur ses voisins en leur accordant le droit de vote. Paradoxe d’une société qui bafoue régulièrement les droits les plus élémentaires des femmes.
Mohamed Bilal, alias Cat, chez elle à Lahore. (Photo Diego Ibarra Sanchez)
Almas Bobby, 45 ans, leader charismatique des hijras du pays qui se dit «hermaphrodite de naissance», s’est battue «pendant quinze ans» pour l’obtention de ces droits historiques. Regard intense surligné de khôl, cheveux de jais, elle reçoit dans le patio de sa maison à Rawalpindi, ville jumelle de la capitale Islamabad, d’où l’on entend la flûte d’un montreur d’ours qui fait danser son animal à une rue de là. Entourée de photos romantiques témoignant de son passé de danseuse, vêtue d’une robe de velours mordoré, elle se félicite du «respect» obtenu auprès de «la police, de la justice et de la société civile» : le niveau des violences policières a en effet diminué ces derniers mois, conséquence des craintes des représailles en justice. Elle dit avoir été «submergée d’émotion» en obtenant récemment sa carte d’identité. Mais le changement se fera «peu à peu», prévient-elle, car «notre société est illettrée et étroite d’esprit». L’avocat Aslam Khaki a ainsi été menacé par des groupes islamistes radicaux, accusé de «promouvoir la culture gay dans le pays».
Au service du fisc
Le respect des droits des eunuques reste un parcours du combattant, comme en témoigne la visite de Sahrish au centre administratif de Karachi : le responsable du bureau a exigé qu’elle fournisse les mêmes documents familiaux que «tout autre citoyen», alors qu’elle a perdu tout contact avec ses proches. «Nous ne délivrons pas de carte d’identité comme ça ; notre voisin, c’est l’Afghanistan ! Comment pouvez-vous prouver que ces deux personnes ne sont pas des espions étrangers !» a-t-il lancé à Libération, un brin excédé. Et Sahrish est repartie bredouille et «triste».
L’intégration des hijras avance néanmoins en empruntant des voies surprenantes. Dans l’un des quartiers les plus huppés de Karachi, le «troisième sexe» a trouvé une utilité sociale, au service du fisc de ce pays de 180 millions d’habitants où rares sont ceux qui paient leurs impôts. Depuis deux ans, la municipalité de Clifton, quartier aisé de Karachi, emploie une dizaine d’eunuques pour distribuer en mains propres les avis d’impôts, puis les factures et, quelques mois plus tard, collecter l’argent afin de le remettre à la municipalité. Pourquoi une telle stratégie ? Sandales à strass et rouge à lèvres rose, Bebo Hasan, 27 ans, s’apprête en cette après-midi de janvier à partir à l’assaut des villas luxueuses de Clifton. Elle explique de sa voix suave au phrasé maniéré que lorsque le propriétaire refuse d’ouvrir les portes ou de payer, les hijras n’hésitent pas à faire du scandale devant la résidence réfractaire en usant bruyamment de leur excentricité. «C’est une grande source d’embarras pour ces mauvais payeurs», relève avec malice Aziz Suharwardy, l’un des initiateurs du recrutement des eunuques à Clifton.
Après des années de confinement chez elle et de dépendance envers sa famille, Bebo arpente désormais avec une assurance certaine les rues d’un monde encore inaccessible il y a peu.
Le chemin du bonheur est plus tortueux pour la discrète Akbari, «binôme» de Bebo dans ses tournées fiscales à Clifton. Son maquillage épais peine à éclipser un visage éprouvé par les souffrances et une carrure de rugbyman. «Toute petite, j’aimais danser, me faire les ongles, mettre des vêtements de fille. Mes parents m’ont battue pendant des années jusqu’à ce qu’ils comprennent que je ne changerai pas», raconte-t-elle. A 35 ans, elle a laissé derrière elle les soirées de danse tarifées aux épilogues sordides. Décrocher cet emploi stable de collecteur d’impôts lui a permis de gagner enfin «du respect» dans sa famille. «Ce fut le plus beau jour de ma vie», se souvient-elle. Leur tournée achevée, bras dessus, bras dessous, Bebo et Akbari s’enfoncent dans la circulation de Karachi avec des envies de shopping. «Peut-être un film indien ou un nouveau rouge à lèvres !» sourit Bebo. Histoire de profiter de la vie.