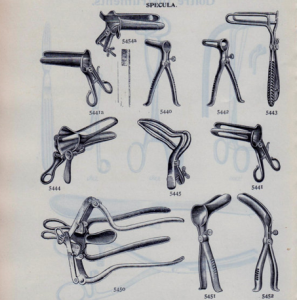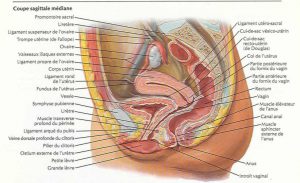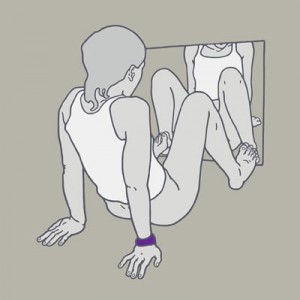Essentiellement constitué de témoignages, cet ouvrage est l’aboutissement d’une réflexion collective.
Il est le fruit de la solidarité entre des jardinières d’Ariège et des travailleuse exploitées au sein d’une asociation « écolo », Kokopelli, dont l’objet est de diffuser des semences.
« Nous avons refusé de tolérer la banalité du mal que constitue le rapport salarial, quoiqu’il soit partout présenté comme normal, naturel. Occulté par un écran de fumée mystique, la banale recherche de profit devient un sauvetage de la « Vie », et la salariat un engagement aux côtés des forces du Bien. »
Les Garnements rétifs aux injonctions des maîtres minuscules (le Grimm) se sont acoquinés pour faire la critique, rare mais nécéssaire, d’une forme exemplaire de capitalisme vert
__________________________________________________________________________________
à lire sur le même sujet:
Kokopelli, c’est fini... paru dans CQFD n°155 (juin 2017), par Joseph Alexandre Le monde associatif n’est pas toujours plus reluisant que celui de l’entreprise. Il même s’avère parfois pire. Illustration avec le cas d’une association reconnue, figure de la défense de la diversité des semences, Kokopelli. Elle entend œuvrer « pour la Libération de la semence et de l’humus et la protection de la biodiversité alimentaire » – rien de moins. Depuis 1999, Kokopelli difuse des semences de variétés libres de droits et édite un catalogue devenu référence. De quoi faire de l’association une icône de la défense des semences face à l’agro-industrie. En apparence, du moins. Parce qu’en réalité, exploitation et management moderne, théorie du complot et tromperie humanitaire ont cours au sein de Kokopelli. Une réalité décrite dans Nous n’irons plus pointer chez Gaïa, paru récemment aux éditions du bout de la ville. Interview avec quelques-uns des auteurs de ce livre collectif : Martin, salarié à Alès avant que l’association ne déménage brutalement, Julie et Laura, anciennes salariées en Ariège, et Bénédicte, jardinière et cofondatrice d’un réseau d’échange de semences en Ariège. CQFD : Le livre commence en évoquant « l’histoire d’une lute salariale qui n’a pas eu lieu » – de quoi s’agit-il ? Martin : À Alès, où je travaillais jusqu’à 2013, l’équipe salariée était consciente de ce qu’était en train de devenir Kokopelli. Nous en faisions les frais, mais nous n’avons pas su réagir avant que l’association ne déménage en Ariège. Et qu’elle nous laisse derrière elle. Laura : En arrivant en Ariège, Kokopelli a accentué ce tournant managérial entamé dans les Cévennes. Nous venions d’être embauchées, mais nous nous sommes rapidement rendu compte de ce qui se tramait. Cela nous a choquées, bien sûr, et nous sommes passées « du côté obscur ». Parler des pauses, d’une mutuelle, ou simplement évoquer nos droits élémentaires de salariées faisait en efet de nous des ennemies. Je me suis mise en arrêt de travail, sans avoir le courage d’aller plus loin. On peut donc dire qu’il n’y a pas eu davantage de réaction collective des salariées en Ariège qu’à Alès. Julie : Nous pensions travailler pour une association militante, mais nous avons vite compris que nous n’étions en réalité que des manutentionnaires pour une plate-forme de vente de semences en ligne. Les méthodes de direction relevaient d’ailleurs du productivisme le plus banal : pointeuse, silence de rigueur,« évaluation individualisée de la productivité », surveillance. Et impossible de contester quoi que ce soit, sous peine d’être accusés de saboter la mission de « sauvetage de la Vie » que la direction prétendait mener. Malgré cete absence de combat, vous vous êtes quand même lancés dans une écriture collective ? Julie : Il n’était pas question que chacun.e reste dans son coin, comme une victime traumatisée. Quelques salariés ont donc décidé de témoigner et d’analyser la forme particulière d’exploitation que peut produire le monde associatif – avec l’idée de politiser cete histoire. Et des jardinières du coin, qui mènent un travail de conservation des variétés potagères, se sont associées au projet par solidarité. C’était le début de deux ans de discussions et d’écriture collective. Bénédicte : Je suis l’une de ces jardinières. Engagée contre l’appauvrissement de la diversité cultivée, j’étais – comme d’autres – adhérente de Kokopelli depuis des années. Mais j’ai vite déchanté quand l’association a débarqué en Ariège. Et je n’étais pas la seule : il y a eu une prise de conscience collective, partagée avec d’autres jardinières. Hors de question « de tolérer la banalité du mal que constitue le rapport salarial ». Dans le livre, on découvre dans quelles conditions sont produites les semences vendues par l’association... Martin : Kokopelli se présente comme un réseau de petits producteurs paysans, sauf qu’à l’époque, en 2013, une proportion non négligeable de semences était achetée à des grossistes produisant à bas coût, comme Suba en Italie. Les petits producteurs étaient peu nombreux en réalité. Travaillant sans contrat, ils devaient de toute façon reproduire un trop grand nombre de variétés pour permetre une qualité satisfaisante. Ce dont Kokopelli n’avait cure, l’essentiel étant de maintenir l’image de marque d’un catalogue à la diversité fabuleuse. La dimension collective de la production de semences (échanges sur les techniques de production, travail en commun...) n’était pas favorisée, voire proscrite par la direction. Certains producteurs en parlent dans le livre, même si ç’a été difcile d’en trouver qui témoignent – ils avaient peur de « faire du tort à la cause des semences libres ». Bénédicte : Les échanges sont indispensables – on le souligne d’ailleurs largement dans le livre. En Ariège, notre petit réseau d’échanges, semblable à ceux qui existent un peu partout en France, est ainsi né de la nécessité de reproduire des semences pour alimenter nos jardins vivriers. C’est une conservation vivante, forcément plurielle : certaines contraintes techniques obligent à s’organiser collectivement – et c’est tant mieux comme ça. Kokopelli, elle, s’en fche. Ce qui l’intéresse, c’est de proposer un catalogue pléthorique de semences à vendre. Lequel renforce au fondune logique de consommation individuelle et véhicule une vision amputée de la semence. Kokopelli a aussi l’image d’un réseau international qui mène des actions humanitaires vers d’autres continents. Qu’en est-il en réalité ? Laura : J’ai justement été embauchée pour travailler sur Semences sans frontières, la vitrine humanitaire de l’association, qui draine beaucoup de dons en argent ou en semences. Et je suis tombée des nues ! Dans les faits, il s’agissait d’envoyer des semences souvent périmées, c’est-à-dire des invendus de la boutique aux durées de germination dépassées de plusieurs années. Les envois ne prenaient en compte ni le climat ni les habitudes culinaires des gens sur place. Il fallait envoyer des colis pour dire qu’on l’avait fait, peu importait leur contenu et leur usage. Comme pour donner raison à Dominique Guillet, le président, qui prétend : « Tout pousse partout s’il y a de l’amour... » Vous revenez aussi dans le livre sur les discours mystiques et complotistes développés par un dirigeant de cete structure ? Julie : Avant mon arrivée dans l’association, je n’avais pas vraiment prêté atention au discours idéologique qu’elle produit. De prime abord, les propos des dirigeants me semblaient plutôt anticapitalistes. Mais en réalité, certains d’entre eux alimentent la confusion politique de l’époque. À les en croire, le monde serait dirigé par une poignée de « prédateurs psychopathes déments » complotant pour éradiquer une partie de la population. Les cancers et les ravages de l’agriculture industrielle seraient notamment les moyens d’accomplir ce programme eugéniste immémorial. Un discours qui s’appuie sur le fait que les semences ont une dimension sacrée dans de nombreuses cultures. Ce qui permet de développer un écologisme mystique, voire réactionnaire, et un militantisme moral et apolitique.